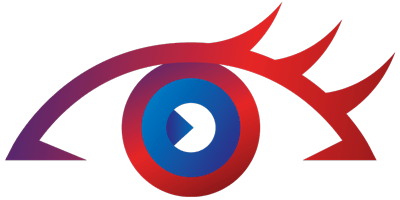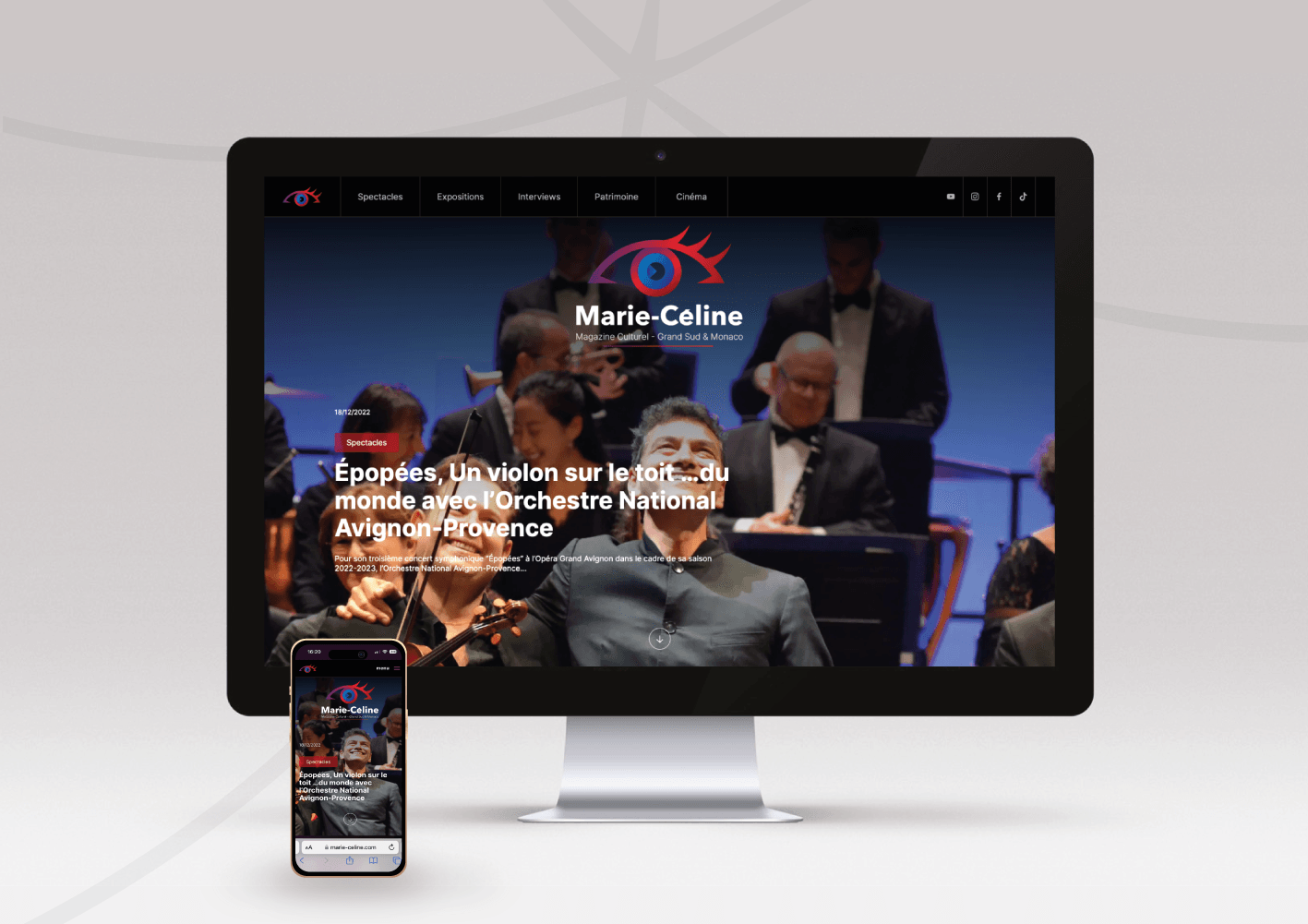- Auteur Danielle Dufour-Verna
- Temps de lecture 57 min
La Culture face à la déshumanisation – Charlotte Delbo

La romancière franco-suisse Ghislaine Dunant présentait une conférence sur Charlotte Delbo "La Vie retrouvée" autour de la culture face à la déshumanisation.
Retranscription de cette conférence au Théâtre Toursky de Marseille.
La culture face à la déshumanisation : Cycle « Soin, Culture et Démocratie » présenté par Roland Gori, Marie-José Del Volgo, Richard Martin
Conférence de Ghislaine Dunant, "Charlotte Delbo La vie retrouvée" - Au Théâtre Toursky
« Dans une société qui promeut l’excellence, la performance, la conception d’un individu auto-entrepreneur de lui-même, le soin ne cesse d’être relégué à une place secondaire. Serait-il devenu superflu ? Pourtant dans une culture de soi et des autres, le prendre soin n’est- il pas l’une des conditions premières d’une démocratie vivante, soucieuse de former des citoyens responsables ?
Ce cycle consacré au soin dans ses liens avec la culture et la démocratie, entend réhabiliter sa place essentielle dans notre société. Faute de quoi, ne risquons-nous pas de perdre chaque jour davantage notre âme et le sens de notre vie ? » (cf programme théâtre Toursky)
Deuxième université populaire gratuite ce jeudi 3 octobre 2019, avec ce soir Ghislaine Dunant, Roland Gori, psychanalyste, professeur émérite de psychologie et de psychopathologie, écrivain et conférencier, Marie-José Del Volgo, maitre de conférences, membre du laboratoire de psychopathologie clinique et directeur de recherche dans la formation doctorale de psychologie et Richard Martin, comédien-saltimbanque, metteur en scène et directeur du Théâtre Toursky.
En 2016 La romancière franco-suisse Ghislaine Dunant publie "Charlotte Delbo, la vie retrouvée" (Grasset), Prix Femina essai 2016, une biographie élogieuse de l'auteure engagée et résistante. Elle vient ce soir ‘narrer’ Charlotte Delbo.
‘Le narrateur, quelque familier que nous soit ce nom, est loin de nous être entièrement présent dans son activité vivante’
Walter Benjamin
Il est de plus en plus rare de rencontrer des gens qui sachent raconter une histoire.
Ghislaine Dunant est une merveilleuse conteuse, une passeuse de mots. Mais pas seulement. Avec les mots, l'autrice transmet la densité, la chair même du récit.
Il était impossible à la journaliste que je suis de ne pas retranscrire littéralement la conférence de cette splendide Université Populaire.
A un moment où notre civilisation chancelle, où l’humanité, si elle ne se réveille pas, peut perdre son sens, cette Université Populaire et le livre de Ghislaine Dunant sont des remparts à la barbarie. Il me fallait la retranscrire dans son intégralité, d’autant plus que Charlotte Delbo, dont Ghislaine Dunant nous parle, n’a pas été reconnue alors qu’elle retranscrivait mot à mot les discours de Louis Jouvet. Comme un clin d’œil à cette femme, voici, à marquer d’une pierre blanche, cette conférence et les propos échangés, riches, intenses.
En voici donc la retranscription :
Richard Martin :
Merci d’être fidèle à ces rendez-vous qui sont précieux. Je veux immédiatement remercier Ghislaine Dunant. Nous sommes heureux Roland, Marie-Jo et moi-même de vous avoir dans cette maison. Je vous renouvelle l’adresse du théâtre puisque maintenant elle vous appartient. Roland, merci de conduire encore ce travail, à Marie-Jo d’y participer, et moi, saltimbanque de service, je vais vous lire un petit moment de ce poème d’Apollinaire ‘La maison des morts’.
‘Et le mort disait à la vivante, nous serions si heureux ensemble. Sur nous, l’eau se refermera et vous pleurez et vos mains tremblent. Aucun de nous ne reviendra… Dans la ville notre troupe diminuait peu à peu. On se disait au-revoir, à demain, à bientôt… Bientôt je restai seule avec ces morts qui s’en allaient tout droit au cimetière où sous les arcades je les reconnus, couchés, immobiles et bien vêtus, attendant la sépulture derrière les vitrines. Ils ne se doutaient pas de ce qu’il s’était passé mais les vivants ont gardé le souvenir. C’était un bonheur inespéré, si certain qu’ils ne craignaient point de le perdre. Ils vivaient si noblement que ceux qui la veille encore les regardaient comme leurs égaux ou même quelque chose de moins, admiraient maintenant leur puissance, leur richesse et leur génie car y a-t’il rien qui vous élève comme d’avoir aimé un mort ou une morte. On devient si pur qu’on en arrive, dans les glaciers de la mémoire, à se confondre avec le souvenir. On est fortifié pour la vie et l’on n’a plus besoin de personne’
‘Aucun de nous ne reviendra’ Charlotte Delbo
‘Le soin, la culture et la démocratie’
Roland Gori :
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci une fois encore à la générosité de Richard de nous accueillir dans le cadre de ces Universités populaires que nous avons intitulé cette année ‘Le soin, la culture et la démocratie’.
Est-ce que ce sont des synonymes ? C’est un peu le défi que nous vous proposons. Nous sommes particulièrement heureux de recevoir Ghislaine Dunant qui va parler de Charlotte Delbo. J’ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer Ghislaine Dunant à Mulhouse où nous étions invités par un libraire extraordinaire de la librairie ‘43e méridien’, à faire deux conférences et j’ai ‘rencontré’ Charlotte Delbo. J’ai ensuite commencé à lire ce livre magnifique qui m’a inspiré pour quelques pages dans un de mes livres pour évoquer ce dont vous allez nous parler ce soir, c’est-à-dire la littérature et l’écriture comme remparts à la barbarie.
Ghislaine Dunant :
Bonsoir. Je suis très heureuse d’être là. Richard Martin, merci de votre accueil comme celui de Roland Gori et de Marie-José. La première chose que je voudrais dire c’est que je ne m’attendais pas du tout à ce que vous lisiez ce poème d’Apollinaire. C’est dans ce poème que Charlotte Delbo a trouvé ce vers ‘Aucun de nous ne reviendra’ et j’ai découvert, en croisant des informations, dans quelle situation elle l’a entendu, ce qu’elle ne raconte jamais. Ce poème a été dit par Danielle Casanova*, ce qui n’est pas dit dans le texte mais que j’ai retrouvé sur le manuscrit. C’est Danielle qui va se lever parmi toutes celles qui sont enfermées au fort de Romainville.
Charlotte Delbo fait partie d’un groupe de résistantes et de résistants qui ont été arrêtés par les Brigades Spéciales en 1942 et la plupart se sont trouvés enfermés au Fort de Romainville. De là, pour des raisons que les historiens ne s’expliquent encore pas, un groupe de 230 femmes va être déporté à Auschwitz Birkenau et non pas à Ravensbruck comme l’étaient habituellement les prisonniers politiques. Cela sera quelque chose de très important dans l’œuvre de Charlotte Delbo. Elle est enfermée d’abord à la prison de la Santé puis amenée le 24 août au Fort de Romainville où elle va rester cinq mois. Son époux, militant communiste est assassiné et fusillé au Mont Valérien déjà au mois de mai 42. Le 20 septembre 42 un officier allemand vient dans la chambrée avec une liste demander à 17 femmes de le suivre et surtout de ramener le linge des hommes qu’elles raccommodaient qui étaient des résistants enfermés dans une salle à côté. Personne ne sait pourquoi.
Charlotte Delbo, résistante
L’officier leur dit : « vous allez leur dire adieu, ils partent pour une autre destination ». En fait, ils ont tous été fusillés. Lorsque ces femmes vont revenir, quelqu’un a dit à une des femmes que ces maris allaient être fusillés. On n’a rien dit ni aux hommes, ni aux femmes. Lorsque les femmes reviennent, elles ont un tel air de consternation, elles ne parlent pas. Je vous lis l’extrait qui raconte comment ce poème a été lu :
"Nous les attendions. Une sorte de détente s’opère en nous, quelque chose cède en nous quand nous voyons qu’elles sont toutes là. Nous attendions un récit, non, elles regagnaient leur lit. Chacune allait à sa place sans un mot avec des yeux devenus sans regard…. J’en entends une qui dit dans un groupe dans un murmure ‘René a dit à Betty qu’ils devaient être fusillés mais qu’ils avaient tous résolu de n’en rien dire aux femmes, de faire croire qu’ils étaient déportés. Naturellement à Betty il pouvait le dire mais seulement il ne faut pas le répéter. Alors, l’une de nous s’est avancé vers le milieu du dortoir et à haute voix, s’adressant à toutes : « Les amies, puisque nous avons encore du temps avant le coucher, nous devrions lire les poèmes. » Les plus jeunes disposent les bancs. Tout le monde s’installe. C’était comme le premier repas après l’enterrement quand quelqu’un s’essaie aux mots familiers et réussit à parler aux autres du boire et du manger. » Cela me parait très important de refaire la cohésion avec des mots très simples. Ici c’est avec un poème. « Mais quand la récitante dit ‘ … car il n’y a rien qui vous élève comme d’avoir aimé un mort ou une morte, on est fortifié pour la vie et l’on n’a plus besoin de personne’ chacune a su à l’impact de ces paroles que malgré le mensonge des hommes et l’hypocrisie du commandant avec le linge à rendre, chacune a su qu’elle avait eu tout de suite le sentiment de la mort et sa certitude. Ils étaient courageux et tendres, les hommes que nous aimions. "
Voilà, je trouve poignant, à tous points de vue, cette façon d’abord de penser qu’à l’époque, la poésie jouait un rôle important. Toutes ces femmes qui sont enfermées à Romainville et qui seront déportées sont des femmes qui pour la plupart n’ont pas le certificat d’études. Mais la poésie, dans les écoles primaires où on apprenait par cœur, était quelque chose d’extrêmement important. On le sent là et quand l’une dit par rapport à cette tragédie que toutes sont en train de vivre ‘Nous allons dire un de nos poèmes’, c’est celui-ci qui est dit et ce que j’aime c’est la remarque que j’ai particulièrement soulignée, c’est-à-dire c’est comme les premiers mots au moment du repas qui suit un enterrement, pour que la parole reprenne, pour qu’il y ait de nouveau du lien, par-dessus la mort et pas n’importe quelle mort : l’assassinat par les nazis des résistants. C’est la première fois, parmi toutes les rencontres que j’aie pu avoir avec ce livre, que quelqu’un a cette idée et c’est pour moi très poignant et surtout l’occasion, la possibilité de parler de ce que fait Charlotte Delbo avec cet évènement qui nous dit beaucoup de ces femmes, beaucoup de cette époque où la poésie était le patrimoine que chacun pouvait avoir en soi. On avait cela dans le cœur et par rapport à une situation aussi dramatique où la parole est empêchée. Quand le commandant les a ramenées, les femmes n’ont pas pu dire un mot par contre on peut écouter une poésie et le lien se fait.
Charlotte Delbo : "Aucun de nous reviendra"
" je veux écrire un livre qui soit l’équivalent de la tragédie que nous vivons et il s’appellera ‘aucun de nous ne reviendra. "
Quand vous parlez de culture et de soin, voilà un exemple absolument étonnant. Merci à vous. Jusqu’à présent je n’avais écrit que des romans. L’œuvre de Charlotte Delbo était la seule de toutes les œuvres sur les camps de concentration qui me faisait l’effet qu’elle m’a fait et pour essayer d’approcher cet effet, de vous en dire quelque chose, je peux déjà simplement dire que c’est la seule œuvre qui me raccordait à ce qui s’était passé, à la catastrophe d’Auschwitz. Or, j’étais frappée de cet effet car je connaissais bien Primo Levi, l’œuvre de Robert Antelme … L’espèce humaine avait une très grande importance pour moi, ou l’œuvre d’Imre Kartech par exemple ou de Boris Pahors, je pourrais en citer beaucoup. Ce qui se passait avec Charlotte Delbo ne se rapportait à aucun autre effet que j’avais, or c’était l’auteur la moins connue. Quand on entend parler de l’œuvre littéraire sur les camps on ne cite pratiquement jamais Charlotte Delbo. Personnellement j’en avais une immense tristesse, une sorte de colère aussi. L’autre chose c’était que j’avais envie de savoir mais comment elle fait, en tant qu’écrivain, comment produit-elle cet effet, qu’est-ce-que c’est que cette œuvre pour, en qualité de lecteur lambda, me faire un pareil effet. En fait je me suis lancée en 2010 et finalement j’ai mis sept ans à l’écrire. Je me suis rendue compte que j’avais traversé une immense période, le 20e siècle. Charlotte Delbo est née en 1913 et meurt en 1985. Ce qui est important car elle est notre contemporaine. Elle écrit six livres, pas de livres longs, qui vont sur 36 ans, de 1946 à 1982, des livres assez courts qui sont tous une façon de raconter sa déportation avec une métamorphose dans la façon de la raconter. On n’a pas du tout le même rendu littéraire, la même conscience, le même point de vue et le même travail littéraire. Pour le premier livre ‘Aucun de nous ne reviendra’, elle disait en avoir eu l’idée au camp de Ravensbruck car elle passe 12 mois au grand camp de Birkenau, un camp encore plus terrible que celui d’Auschwitz, c’est là où se trouvaient les femmes et six mois au petit camp de Raisko qui est un laboratoire agricole et c’est comme cela qu’elle a pu avoir la vie sauve car là il y avait des paillasses et des douches. C’était un lieu d’expérimentation agricole pour fabriquer du coczakis, une sorte de racine de pissenlit qu’ils avaient ramené d’Ukraine, et les nazis pensaient qu’avec cela ils pourraient faire du caoutchouc. A Ravensbruck, Charlotte Delbo dit à une compagne : « je veux écrire un livre qui soit l’équivalent de la tragédie que nous vivons et il s’appellera ‘aucun de nous ne reviendra. »
Charlotte Delbo fait 27 mois de déportation
Elle sort de Birkenau pour partir à Ravensbruck en janvier 44 et sera libérée en avril 1945. Charlotte Delbo fait 27 mois de déportation. Elle rentre en triste état bien sûr. Pendant trois mois c’est l’asthénie totale, c’est même l’effondrement. Elle va tenter de reprendre auprès de Jouvet et dès qu’elle pourra tenir un stylo en main comme elle dit, elle écrit ‘Aucun de nous ne reviendra’, d’un jet entre 3 semaines à un mois. Elle ne choisit pas d’écrire dans le premier chapitre, chose étonnante, leur arrivée après trois jours et trois nuits dans les wagons de bestiaux. On est en plein hiver. Elle arrive le 27 janvier 1943. Elles sont parties le 24 de la gare de Compiègne. Elle raconte que le wagon s’était arrêté toute la nuit au bout des rails de Birkenau ; donc la nuit glaciale et au matin, les soldats enlèvent le plomb, ouvrent les portes des wagons et leur arrivée est stupéfiante. Toutes, celles qui sont rentrées, seulement 49 sur 230, la première chose qu’elles raconteront, c’est l’impression terrible que leur a fait cette plaine venteuse où souffle le blizzard, blanche de neige et de givre et les cris surtout des nazis, et les chiens, et le clic-clac des mitraillettes.
'Il y a ceux qui partent et qui embrassent ceux qui les ont accompagnés. Il y a ceux qui arrivent et qui cherchent dans la foule ceux qui les attendent et à qui ils vont raconter qu’ils sont fatigués du voyage’.
Charlotte Delbo l'un des écrivains majeurs de la deuxième partie du 20e siècle
Ce n’est pas cela que Charlotte Delbo va raconter, elle raconte dans un chapitre au nom très étrange : ‘Rue du départ, rue de l’arrivée’. On lit les douze premières lignes et c’est :
‘Il y a ceux qui partent et qui embrassent ceux qui les ont accompagnés. Il y a ceux qui arrivent et qui cherchent dans la foule ceux qui les attendent et à qui ils vont raconter qu’ils sont fatigués du voyage’. On se demande mais qu’est-ce qu’elle raconte. Ceux qui sont allés à Paris savent que rue du départ et rue de l’arrivée, cela ressemble à la gare Montparnasse. Il y a un café qui s’appelle À l’arrivée, un café qui s’appelle Au départ. On les retrouve toujours. C’est toujours des ‘Il y a, il y a’ sur douze lignes puis un blanc ‘mais il est une gare où ceux qui partent n’arrivent jamais’. Il est une gare où ceux qui sont partis ne sont jamais arrivés. Je trouve cela stupéfiant. Après ce ‘il y a… il y a’ du verbe avoir, on passe au verbe être. Quand on sait ce que c’est que l’avoir, on change d’ordre et on est dans l’être. Elle dit aussi que le langage n’a plus de sens. Il n’y a plus de vérité dans le langage, et cela c’est Auschwitz. Je trouve extraordinaire qu’un travail d’écrivain soit arrivé en quelques mots –on est dans la première page- à montrer que le langage n’a plus de sens. Je tiens Charlotte Delbo pour un des écrivains majeurs de la deuxième partie du 20e siècle. Ce sont les écrivains de langue allemande qui ont travaillé sur le langage et montré ce que les nazis avaient fait au langage, et le travail qu’ils ont pu faire, eux, après 1947, sur la langue allemande. C’est très important car là, en France, nous avons un écrivain qui a fait ce travail sur la langue pour montrer qu’elle a pu perdre son sens, en trois, quatre lignes. Le chapitre continue et ce qui me stupéfait, c’est qu’elle va prendre le temps pendant neuf pages –le chapitre en comporte 12- de raconter ceux qui descendent d’un train.
'Charlotte Delbo a le contrechamp en voyant les personnes qui descendent, des fumées et de l’odeur des crématoires. Ce sont des personnes qui descendent et elle, Charlotte Delbo, va prendre le temps de raconter comment sont ces personnes '
En fait c’est un convoi de Juifs qui arrivent de l’Est de l’Europe. Elle va raconter ceux qui descendent du train. Elle a pu les voir car, un jour, alors qu’elles allaient au mois de mai à pied du camp de Birkenau au laboratoire agricole de Raisko –ce qu’elles ont fait pendant deux mois avant d’être logées à côté du laboratoire car le bâtiment des laborenthines n’était pas encore construit- elles sont arrêtées près des voies par un convoi qui arrivait.
Donc elles ont vu et cela se passe quatre mois après leur arrivée.
Ce qui est très important et si j’ose m’exprimer ainsi, c’est que Charlotte Delbo a le contrechamp en voyant les personnes qui descendent, des fumées et de l’odeur des crématoires. Ce sont des personnes qui descendent et elle, Charlotte Delbo, va prendre le temps de raconter comment sont ces personnes ; comment elles sont habillées, ce qui révèlent de là où elles viennent : d’Ukraine, de Grèce, de Macédoine, d’Italie, de Lituanie. Elle égraine comme cela un nombre de pays et elle raconte l’homme, le Rabin, qui a encore le châle sur les épaules, ou le couple de mariés qui sort de la synagogue, elle est encore habillée en mariée, lui a encore son frac. Ou ce sont des fillettes d’un pensionnat avec la maitresse qui, après la descente du train, les remet en rang car il faut se tenir bien quand on arrive dans un endroit qu’on ne connait pas encore -puisqu’on leur a dit qu’elles arriveraient dans un camp pour travailler. Elle demande donc aux fillettes de remonter leurs chaussettes. C’est extrêmement important que Charlotte Delbo prend ce temps pour ‘dire’ les personnes car comme vous le savez, nous, on a toujours su la suite grâce aux historiens. Nous, ce que nous connaissons ce sont les camions qui attendent pour ceux qui ne peuvent pas marcher, c’est ce qui va se passer deux heures après où ils rentreront tous dans ce qu’on leur a dit ‘la salle de douche’, c’est-à-dire la chambre à gaz. Nous, nous savons la suite, mais nous ne savons pas les personnes qui descendent. On ne les a pas vues.
Et tout-à-coup un écrivain prend le temps de les raconter, de ce qu’ils devaient faire avant :
« Il y avait des intellectuels, il y avait des musiciens qui avaient encore leurs instruments. Il y avait ceux qui devaient être ou fourreurs ou médecins. Il y avait les vieilles gens qui sont arrivés et qui regardaient autour d’eux, très surpris de ce qu’ils voyaient et de cette désolation autour d’eux et qui, eux, ne connaissais l’étranger que par les cartes postales que leur envoyaient leurs enfants qui avaient émigré : ‘Ils seront étonnés quand nous leur raconterons’.
Cette simple phrase montre que Charlotte Delbo leur crée une mémoire, un futur, à ces gens qui vont mourir deux heures après. C’est cette humanité dans la langue par rapport à une histoire que nous avons toujours lue massacrée, l’histoire elle-même, sans suite évidemment avec ce qui se passe tragiquement, elle, elle raconte autre chose. Elle montre des personnes. Voilà ce qui me stupéfait et me touche grandement dans l’écriture de Charlotte Delbo.
Charlotte Delbo et ses origines
Son nom Delbo est d’origine italienne. Elle est l’ainée des quatre enfants, fille et petite-fille d’immigrés italiens qui ont fui le nord de l’Italie et la misère économique. Son grand-père Carlo s’est installé en France pour travailler comme monteur des grandes poutres métalliques. Son père, Charles sera ouvrier spécialisé, chef monteur riveteur. Il aura une équipe de quelques ouvriers qui travailleront avec lui. Ils vont comme cela changer de lieux en France pour suivre les chantiers du père. La mère est italienne d’origine, arrivée à 18 ans en France sans parler le Français. Charlotte a toujours eu une vénération et une reconnaissance pour sa mère qui a appris le français en arrivant et qui a toujours parlé le français à ses enfants. Charlotte Delbo aura cet amour de la langue française qu’ont justement dont ce n’est pas une langue reçue depuis si longtemps mais une langue acquise. Toutes ces choses ont aujourd’hui pour nous un écho extrêmement important. Charlotte ne fera pas d’études, elle n’a pas son baccalauréat, mais un appétit de la connaissance absolument extraordinaire, un désir de justice qu’elle avait déjà par sa mère qui lui font très vite se rapprocher des jeunes communistes.
En effet entre 1928 et 35 le parti communiste avait une politique très importante pour donner accès à la culture à ceux qui ne l’avaient pas par leur famille. Elle y sera très sensible et elle a un tel appétit de la connaissance que très vite elle va s’en rapprocher. Elle adhère aux Jeunesses communistes en 1932, mais auparavant elle va suivre les cours du soir de quelqu’un qui s’appelle Henri Lefebvre qui n’est pas encore le grand sociologue qu’il va devenir, qui est professeur de philosophie et qui est surtout quelqu’un qui étudie la pensée du jeune Marx qui était antiétatique ce qui est encore très particulier et va changer plus tard. Ce qui pouvait séduire la libertaire qu’était Charlotte. Elle rencontrera dans ces cours du soir Georges Dudach, ce militant communiste qui lui est chargé de la presse pour la jeunesse. Le parti va lui confier en 1936 au moment du Front populaire, ce nouveau mensuel qui est ‘les cahiers de la jeunesse’ dont le premier numéro sort en 37 et parmi les premiers numéros, il y a un grand entretien sur le cinéma.
Charlotte Delbo et Louis Jouvet
Charlotte qui y travaille va interviewer Louis Jouvet, l’acteur le plus connu du cinéma. Elle fait un entretien avec lui et elle est étonnée car il parle essentiellement du théâtre avec un assez grand mépris du cinéma. La seule chose qui intéressait Jouvet c’était faire du cinéma pour avoir l’argent pour faire ses mises-en-scène de théâtre. Jouvet est le redécouvreur de Molière et évidemment le plus grand metteur-en-scène à l’époque.
Elle envoie son article au théâtre avant de le publier au cahier de la jeunesse. Il la convoque. Elle est affolée, de peur qu’il soit mécontent. Elle arrive, tremblante et lui dit : ‘
Mademoiselle, comment avez-vous fait ? C’est la première fois que je vois mes propos exactement reproduits’. Elle lui répond qu’elle a une formation de sténodactylo, qu’elle a pris en sténo tout ce qu’il lui a dit et je me suis chargée, chez moi, de le rendre dans une langue écrite. Il se tourne vers elle et lui dis. « Mademoiselle, j’ai besoin de vous. Je donne des cours au conservatoire chaque semaine. Je parle pendant deux heures. J’emploie énormément de métaphores et j’ai besoin que quelqu’un me rende absolument tout ce que je dis, toutes mes digressions où parfois je passe mes deux heures sur deux vers de Racine ou sur une tirade de Molière. J’ai besoin qu’on reprenne tout ce que je dis pour après, faire des conférences. »
Vous imaginez cette jeune-fille éprise de littérature depuis son adolescence, qui allait au théâtre ‘au poulailler’. La même semaine, à 19 ans, elle avait vu ‘L’école des femmes’ à la Comédie Française et au Studio théâtre avec les mises en scène de Jouvet. Et elle disait ‘On s’endormait à la Comédie Française, on riait aux éclats au spectacle de Jouvet'. Elle est admirative et elle est du jour au lendemain embauchée par Jouvet comme assistante et va l’accompagner au conservatoire. Ce qu’elle va faire pendant quatre années avant d’être arrêtée et déportée. C’est très important cet espèce de cahier de brouillon de l’écrivain –on dirait les gammes pour un musicien- . Elle a entendu la langue des classiques que Jouvet faisait travailler à ses comédiens pendant des heures, avec cette façon de déployer des images. Il faisait parfois appel au galop du cheval pour donner le rythme à Elvire ou en parlant de Dieu ou de ciel, de choses extraordinaires. Elle va entendre cette langue travaillée comme cela. Ce qui est extraordinaire dans l’écriture de Charlotte Delbo c’est qu’on voit par sa langue qu’elle est quelqu’un nourrie de littérature classique qui va lui imprégner un rythme moderne qui est dû à ce qu’elle a vu et ce qu’elle veut rendre. Elle se rend compte qu’il faut un langage à la mesure à la fois de la violence de ce qu’elle a vu et également à la mesure de l’amour –c’est cela que je trouve extraordinaire- qu’elle portera toujours aux martyres qu’elle décrit. Il n’y a jamais un rejet de ce qu’elle voit. Elle raconte des choses qui sont proches de l’épouvante et c’est ce qui a beaucoup fait pour que Charlotte Delbo soit très peu lue. Car c’est vrai que c’est très dur à lire. Elle a une lucidité extraordinaire pour voir exactement et elle a dans l’œil ce fait qu’elle est toujours liée à celles qui souffrent par cette pitié et cette empathie qu’elle a pour celles qui sont en train de vivre ce qu’elle vit. Et il y a cette autre dimension humaine qui est cette horreur intérieure qu’on peut ressentir par rapport à ce qu’on inflige à quelqu’un. Je n’ai jamais lu un écrivain qui sache écrire la douleur comme elle, la douleur physique bien entendu de ce qu’elle enduré, de ce qu’elle a vu endurer, mais la douleur morale aussi qui est dans l’œil de celle qui voit ce qu’on inflige à d’autres.
La mémoire et les jours de Charlotte Delbo
"elle raconte ces hurlements, ces têtes de hiboux car on a rasé les femmes"
Quand elle raconte par exemple les camions qui passent à Birkenau, chargés de celles qu’on a sorties de cour du bloc 25, le bloc à côté du leur, où on a mêlé les mortes et les vivantes et qu’on emmène au crématoire, qu’elle raconte ces hurlements, ces têtes de hiboux car on a rasé les femmes, avec ces yeux caverneux et ces mains qui se tordent vers le ciel, quand elle raconte cela et que l’on sent à la fois la lucidité, celle qui savait ‘dire’ avec des mots tellement précis et tellement justes et ces mots sont à la fois empreints de cette douleur morale qu’elle ressent à le voir. Tout cela est dans son écriture. Ce qu’elle a eu également d’extraordinaire et qu’elle a appris de Jouvet. Dans ses mises-en-scène Jouvet est celui qui a créé l’illusion poétique, pas réaliste comme l’était le théâtre des années 10 et 20 qu’il avait vu très jeune et dont il avait horreur. Lui va chercher avec quelques éléments du décor, à rendre une scène en faisant jouer très fort la situation rendue avec une diction parfaite le texte des auteurs. Il veut montrer que le théâtre rend l’essentiel de la situation humaine en train d’être vécue et non pas raconter une histoire. C’est entrer à l’intérieur de ce qui est vécu, cela avec quelques éléments du décor. Christian Bérard, le décorateur attitré de Louis Jouvet, racontait qu’il s’était inspiré de Meyerhold car Jouvet demandait qu’il n’y ait presque rien sur scène, le vide. Jouvet disait ‘l’école des femmes c’est deux chandeliers, une grille de jardin, une table et le ciel’.
Jouvet donnait de l’importance à l’éclairage et notamment les ciels. J’ai beaucoup pensé à cela en lisant les tableaux que Charlotte Delbo fait de Birkenau. C’est absolument extraordinaire dans les différents chapitres qui sont autant de scènes de ce qu’elle voyait à Birkenau et de ce qu’elles ont subi, ce sont des tableaux où elle va reprendre cet art de la mise en scène, pour décrire avec son œil.
Il y aura des ciels, soit bleus, soit extrêmement pâles, soit mauves au moment où à quatre heures du soir les hivers, le soleil se couche et qu’il y a ce reflet bleuté ou violacé sur la neige glacée. Elle décrit les arbres gelés ‘les arbres dans leur suaire de givre’. Ou pour décrire –c’est l’art de celle qui met des images quand elle rend des sensations ressenties- elle dit ‘le vent nous transperçait pendant les appels interminables. On avait l’impression qu’il soufflait à travers nos côtes et, nos poumons, c’était comme du linge étendu sur une corde et qui claquait au vent’ ; ou tout d’un coup dans un appel interminable ou en rétorsion à ce qu’il se passait à Stalingrad.
Il faut dire que le convoi de Charlotte Delbo arrive au pire moment de la guerre pour les nazis. Ce sera le pire moment de la façon dont elles seront traitées à Birkenau, cet hiver 42-43 où pour la première fois les nazis sont arrêtés sur le front russe. On peut dire que depuis 1938, l’armée allemande, les nazis entrent comme ils veulent partout, sauf l’hiver 42-43 où l’armée russe, les Russes, si étonnants, si célèbres, si héroïques, les arrêtent sur le front. De rage, en mesure de rétorsion, ce sont contre les plus démunis qu’ils s’acharnent. Ils font sortir les 15 000 femmes du camp de Birkenau, debout, sans bouger, dans la neige, de cinq heures du matin à cinq heures du soir. Il faisait moins 28, habillées comme elles l’étaient, c’est-à-dire des haillons sur le corps. Certaines sont folles, hallucinées par l’état de soif, de famine, de maladie. Charlotte Delbo décrit ’une d’entre elles essaie de traverser un fossé pour atteindre de la neige propre pour humecter ses lèvres et avoir quelque chose à boire. Elle fait un effort considérable alors qu’elle n’a plus que les os sur le corps. Elle porte des haillons jaunes. C’est donc une juive puisque les politiques étaient en rayé et les juives de haillons. '

Charlotte Delbo et la déportation
Charlotte Delbo montre toujours la différence de même que dans les baraquements, elle dira « dans le bloc des juives, elles étaient beaucoup plus nombreuses, certaines devaient rester debout la nuit. » Cette femme qui porte un haillon jaune est tellement squelettique qu’elle dit qu’elle ressemble à un de ces oiseaux au Musée d’Histoire naturelle dont on ne voit plus que les vertèbres et en même temps elle pense au chien qu’elle avait enfant, Flac, qui va mourir. A l’intérieur même du texte –il faut toujours se souvenir que ‘Aucun de nous ne reviendra’ est écrit en 46 quand elle est encore sous l’effet du traumatisme. Comme je vous l’ai dit, après sa déportation, elle racontera d’une façon très différente.- là, sous l’effet de ce traumatisme, c’est l’inconscient qui arrive dans le texte, au milieu du récit « Maman, Flac va mourir. André –c’est son frère- m’a dit que notre chien est en train de mourir. » Parce ce que Flac, leur chien jaune, était en train de mourir, en voyant cette femme, elle voit son chien Flac. Et tout à coup cette femme qui essaie d’attraper de la neige en face n’a plus la force de l’atteindre. Elle voit toutes les femmes derrière. Dans un appel désespéré, elle leur dit ‘Venez m’aider. Sortez-moi de ce fossé d’où je ne sais plus sortir'. Et Charlotte Delbo dit à un moment donné, ‘sa main retombe. C’est comme une fleur mauve décolorée qui flétrit et tombe dans la neige.’ Et tout d’un coup cette fleur qui a perdu sa vie, c’est à la fois, pour elle, cette façon de rendre la tendresse. Je l’ai senti également comme un hommage. C’est cette main violacée ‘comme une fleur mauve flétrie’ et à la fois le silence comme intérieur par rapport à la stupéfaction, à l’horreur, puisque cela a dépassé l’horreur, et en même temps, je ne peux pas m’empêcher de voir un hommage, quelque chose de silencieux à cette femme. Il y a cette complexité dans l’écriture de Charlotte Delbo, ces strates d’écriture.
C’est cela aussi ce travail de la culture : amener ces différents registres de langue à l’intérieur pour dire ce qu’a pu être la catastrophe. Il y a eu, plus tard, un livre étonnant : "Spectre mes compagnons" qu’elle écrira à deux époques de sa vie, la première partie en 1948 quand elle a quitté Jouvet. Elle est partie pour travailler à l’ONU à Genève. Elle avait décidé de garder vingt ans au secret son livre ‘Aucun de nous ne reviendra’. Au moment où les camps sont libérés, les gens veulent savoir. Là ce sont des journalistes et des historiens qui doivent les renseigner. Elle veut faire autre chose qu’informer. Elle veut faire une œuvre qui soit une tragédie comme les tragédies grecques, à la mesure de ce paroxysme de l’histoire qu’elles ont vécu. Par contre il y a cette chose absolument étonnante. Quand elle rentre de convalescence, en juillet 1946, elle l’envoie à Louis Jouvet en lui disant « J’aimerais que vous en lisiez le premier chapitre » ce fameux premier chapitre dont je vous parlais, « peut-être qu’un jour vous auriez même envie de le dire. » Elle fait une lettre très compliquée pour accompagner son envoi à Jouvet, par la poste etc. En fait, elle a peur de son audace.
Quelques jours après, elle reçoit une lettre de Louis Jouvet et j’imagine sa désillusion pour ne pas dire son désappointement. Il lui dit : « Ma petite, il faut le réécrire, tu peux faire mieux. » Et notamment il lui a demandé d’ôter les dix premières lignes qui sont pour moi capitales : parler d’une gare ordinaire, de comment cela se passe d’ordinaire quand on part ou quand on arrive, qui est une marque très importante de l’écriture de Charlotte Delbo, qu’elle aura aussi quand elle écrira l’introduction de ‘Convoi du 24 janvier’, c’est-à-dire parler l’ordinaire.
Derrière l’ordinaire il peut y avoir la tragédie. Ce qui m’intéressait beaucoup comme originalité, car elle a très bien connu le théâtre de Giraudoux que Louis Jouvet a beaucoup monté. Or Giraudoux faisait exactement le contraire. Il a pris de grands thèmes de la Tragédie antique et leur faisait parler un langage prosaïque.
Jouvet ne pouvait pas imaginer que sa secrétaire avait écrit une très grande œuvre, ce qui nous en dit beaucoup sur la façon dont les femmes pouvaient être regardées.
Charlotte fait exactement le contraire dans le but de nous montrer : attention, derrière l’ordinaire, il y a les pires choses qui peuvent arriver. Je pense que quand elle a quitté Jouvet en 47, c’est aussi sa façon de protéger, puisqu’elle ne va rien dire, personne ne sait au fond pourquoi elle part sinon qu’on peut penser qu’elle cherche un salaire meilleur, elle veut protéger à l’intérieur d’elle-même. Jouvet ne pouvait pas imaginer que sa secrétaire avait écrit une très grande œuvre, ce qui nous en dit beaucoup sur la façon dont les femmes pouvaient être regardées. Lui avait engagé cette petite jeune-fille qui était devenue son assistante et pour laquelle il avait une estime, mais il l’appelait fillette… Donc, malgré son départ, elle va voir en 47 la mise-en-scène que fait Jouvet de Don Juan. J’ai trouvé dans ses archives une lettre extraordinaire qu’elle écrit à Jouvet en 48 où elle va analyser son interprétation de Don Juan, et la mise-en-scène et sa façon d’acteur de jouer. Les critiques qu’elle fait sont si justes, si intéressantes, en essayant d’analyser que l’on pourrait voir autrement le défi que Don Juan fait par rapport au Commandeur. Elle parle beaucoup de ce courage de Don Juan. Evidemment parce que lui qui doit aller en enfer, elle, l’enfer, elle sait ce que c’est. Elle est donc particulièrement sensible à ce courage. Elle a envie de donner une autre gloire à Don Juan que le personnage qu’en fait Jouvet. En 48, elle va écrire Spectre mes compagnons qu’elle commence justement comme une lettre fictive à Jouvet : « Cher Louis Jouvet, je vais vous raconter l’extraordinaire voyage que j’ai fait. »
Voilà comment elle parle de sa déportation. Elle va lui rappeler les promenades qu’ils faisaient à Vallauris. C’est une page et demi absolument merveilleuse où elle raconte ces promenades du soir. En fait, Louis Jouvet, est en 1940 à Juan les pins, car le Ministre de l’intérieur de l’époque voulait créer le premier festival de cinéma pour répondre au festival de Venise que l’Italie mussolinienne avait créé et avait demandé à Louis Jouvet, personnage si important du cinéma, d’être là. Louis Jouvet loue une villa pendant un mois pour être présent pendant le festival de Cannes. Les grands acteurs américains qui sont tous conviés ne veulent pas venir car ils sentent la guerre, déclarée en 39, toute proche. Le festival n’a pas lieu. Louis Jouvet est là et veut travailler donc il télégraphie à Charlotte au théâtre de l’Athénée en disant ‘vous venez et on va travailler’. Il veut travailler avec des héros de roman et voir comment on peut en faire des personnages de théâtre. Il veut prendre Julien Sorel, de Le Rouge et Le Noir, un personnage d’un roman de Dickens, etc. Charlotte et Jouvet discutent ensemble toute la journée. Elle doit prendre des notes et il la raccompagne le soir à son hôtel qui est à Saint-Paul de Vence. Ils traversent ces collines de Vallauris. Elle raconte ‘ces champs couverts d’étoiles’. En fait, ce sont les jasmins qui ont poussé dans les champs et qui parfument. Elle dit « dont l’odeur entêtante montait le soir ». « Nous parlions et nos interlocuteurs invisibles nous accompagnaient ». Elle avait encore les voix qu’ils avaient imaginées pour Julien Sorel et d’autres. Cette première idée de personnage de fiction qui accompagne, c’est ce qu’elle va recréer en écrivant ‘Spectres mes compagnons’ et en imaginant par exemple que dans le wagon qui l’emmène à Birkenau, c’est la voix d’Alceste qu’elle entend. Ou, dans la prison de la Santé, dans les murs nus – Charlotte est ‘nuit et brouillard’. Elle n’a même pas le droit d’avoir le chariot des livres. Or sa voisine lui fait passer La Chartreuse de Parme. Charlotte Delbo adorait Stendhal. Elle dit « J’ai dû lui rendre très vite mais Fabrice Del Dongo est resté près de moi. » - il y a une scène absolument extraordinaire où elle raconte la façon où elle comprend tout à coup. Fabrice est assis à côté d’elle. Il lui semble qu’elle peut ressentir le secret de ce personnage. Elle peut dialoguer avec lui. Et lui avait un sens du destin inéluctable qui va être son destin. Voilà aussi un effet de la culture.
La culture c’est aussi ce qui nous ouvre à l’autre. La culture, c’est tout ce que nous avons qui nous appartient en collectif.
Et aussi la façon dont, ce qui appartient à la culture, peut venir près de nous pour nous donner une autre dimension, pour nous permettre de nous voir avec recul, pour nous permettre de nous créer une chambre intérieure. Dans l’Art, quand on travaille, que ce soit la peinture, la sculpture, la musique ou la littérature qui est peut-être la chose que je connais le mieux, ce qui est toujours fait, c’est rendre l’expérience humaine et de la traduire.
Pour la littérature, c’est avec des mots, avec des rythmes, avec une phrase. Mais c’est bien pour rendre de l’expérience humaine, celle qui a pénétré notre chambre intérieure. En ce sens-là, la culture nous permet d’avoir des strates différentes, des possibilités pour nous donner une profondeur plus grande, nous permettre de dialoguer avec nous-même et peut-être de prendre une distance avec le ‘terrible’ qui nous arrive, de nous donner une épaisseur intérieure, donc nous permettre de devenir humain et de partager.
Richard Martin :
Ce n’est pas une rencontre banale. On est dans les repères de l’Histoire et cela intéresse l’humanité. Ce moment que l’on partage ce soir nous appuie sur le cœur d’une façon terrible. On mesure le chemin à faire avec le développement culturel et la désespérance de ces politiques inexistantes. Où est l’Education nationale, où est la recherche ? Ceux qui sont chargés des manettes doivent prendre conscience qu’ils nous mènent à la catastrophe. Tout peut se répéter si on s’enfonce dans la bêtise. Et on s’enfonce dans la bêtise. Il faut de vrais résistants, que tous les saltimbanques soient des guerriers de lumière. On n’a plus que les poètes qui nous éclairent. C’est désespérant car nous sommes au bord du gouffre. J’ai pleuré dix fois sur ce récit ce soir mais on repart vers des choses innommables. Il y a vingt ans que je pense que c’est un cul de sac mais il est élastique. Où va-t-on ? Ghislaine, vous avez un talent de récit exceptionnel. Essayez de réveiller ces imbéciles, donnez-nous des armes.
Ghislaine Dunant :
Si je suis là ce soir, c’est à l’invitation de Roland Gori et dans ses livres il y a cette façon d’appuyer là où ça fait mal pour le politique avec ce qu’il y aurait à faire avec justement politiquement. Je peux vous dire, moi qui avais juré que c’était fini je ne parlerai plus de Charlotte Delbo, quand en mars, Roland m’a fait cette proposition et parce que c’est Roland Gori, voilà, je viendrai à Marseille. Je ne connaissais pas Marie-José, je ne vous connaissais pas encore, je ne connaissais pas le théâtre Toursky ni les personnes qui sont là ce soir, je suis très heureuse d’être venue. Merci de votre invitation.
On devrait être des centaines à entendre ce récit, c’est précieux.
Richard Martin :
On a rejoint Roland pour ‘L’appel des appels’ et on appelle tous les compagnons saltimbanques à venir ajouter leur énergie. On devrait être des centaines à entendre ce récit, c’est précieux. Vous avez cette intelligence rare qui fait que vous pouvez vous adresser à des gens qui sont bornés et qui sont traversés par cette écriture. Le travail des saltimbanques c’est de ‘donner l’alarme avec des cris d’oiseaux’.
Ghislaine Dunant :
Je vous parle, mais la seule chose qui compte pour moi, c’est l’écriture. La seule chose qui a compté pour moi, c’est d’écrire ce livre. J’ai passé un an et demi –j’allais beaucoup à la bibliothèque nationale où j’avais recopié toutes les lettres qu’elle avait écrites à Louis Jouvet. Ce que je voulais, c’était essayer de trouver du sens. Des faits j’en ai trouvé évidemment pendant les années d’enquête que j’ai faites, toutes les personnes que je suis allée voir, qui l’avaient connue, rencontrée. Ce n’est pas cela que je cherchais. J’avais envie qu’il y ait une correspondance entre sa vie et ce qu’elle avait pu écrire et ce que moi je pouvais en tant qu’écrivain dire qu’est-ce-que c’est qu’une conscience d’écrivain qui se fait – car Charlotte Delbo s’est construit une conscience d’écrivain. L’intérêt de tout cela c’est de créer une conscience de lecteur. Comme écrivain j’ai envie que le lecteur –c’est chez lui que le livre s’accomplit vraiment- l’écrivain fait 70 pour cent du livre. La terminaison du livre, c’est la résonance intérieure que les mots, les phrases vont avoir chez le lecteur. Il me fallait trouver, d’une part du sens, c’est-à-dire que j’essaie de déplier quel avait été le travail de Charlotte Delbo, et comment sa vie, extraordinaire, absolument incroyable du début à la fin, avait pu le lui permettre. Je voulais essayer que dans mon livre soit tressé –je n’ai pas mis de chapitres. J’ai supprimé tous les titres de chapitres que j’avais mis ; j’ai fait des passages en blanc. Je voulais que cela soit un fleuve et un seul récit ; qu’il n’y ait pas un seul mot compliqué et qu’à l’analyse de son œuvre, il n’y ait pas un seul mot à la seule forme littéraire. Je voulais rendre l’épaisseur humaine mais il fallait le rendre dans le texte. Donc ce qui compte pour moi c’est que le livre soit lu. J’en parle, mais c’est lire le livre qui peut vous rendre quelque chose.
Roland Gori :
La manière dont vous en parlez m’évoque plusieurs choses. D’abord que vous avez aussi une passion pour la danse et je me disais en vous écoutant, il y a une chorégraphie dans votre manière de parler comme dans votre écriture. Je voulais dire aussi que vous venez juste de recevoir le Prix Fémina. Comme je suis curieux, je suis allé voir et écouter un certain nombre d’émissions. Vous insistez beaucoup là-dessus : ce n’est pas un roman, c’est un récit.
Ghislaine Dunant :
Dès le début, mon idée n’était pas d’écrire une biographie. Il s’est avéré que j’ai déplié toute sa vie. Quand j’ai remis mon livre à l’éditeur, je me suis aperçue que je n’avais mis ni la date de naissance de Charlotte Delbo et je n’ai pas écrit la date de sa mort. Et je l’ai laissé ainsi. J’ai commencé le 10 juin 40 quand les Allemands sont aux portes de Paris, qu’elle est licenciée par Jouvet car il ne peut plus y avoir de travail. Jouvet part à Bordeaux, c’est l’exode. Les allemands vont entrer le 14 juin dans Paris…… Elle retournera à Paris et je trouve extraordinaire cette jeune femme de 26 ans qui décide justement pour qu’on réentende la langue française dans ce Paris occupé, de rouvrir le théâtre, de dire à Louis Jouvet de remonter, qu’il y a des cours au Conservatoire. J’ai voulu ouvrir le livre avec ce premier acte de résistante. Ensuite je parlerai de son enfance etc. Si je voulais que ce récit soit comme un fleuve, c’est d’abord parce que, même si j’ai écrit des romans, pour moi, le récit est un grand genre –ce qui est le cas de mon précédent livre qui se nomme l’effondrement, un récit beaucoup plus court-. C’est un grand genre, d’abord d’une certaine manière c’est l’Iliade et l’Odyssée. J’ai d’ailleurs lu l’Iliade l’été 2011 en entier –j’ai été trois semaines en Grèce- et j’ai retenu cette image d’Homère « L’Hadès, porte close ». L’Hadès, c’est l’enfer et cela reprenait ce que Charlotte Delbo avait montré en disant «Nous étions de l’autre côté du monde, au bord de l’épouvante » et justement cette impression de ‘Hadès, porte close’, c’est-à-dire qu’il n’y aurait pas moyen d’en sortir. L’Iliade c’est aussi une façon de célébrer tous ces héros. Dans le convoi du 24 janvier où elle va faire la biographie de ces 230 femmes dont la plus grande partie, qui avait fait de la résistance, est totalement anonyme et qui vont mourir, elle a essayé de leur redonner un nom, un travail sur des héroïnes anonymes. C’est pour cela que j’avais lu l’Iliade. Si je dis que le récit est un grand genre c’est que parler de Benjamin et penser à son travail sur le conteur où il dit qu’aujourd’hui il n’y a plus de récit et pense encore à cette voie orale, ce qu’elle peut transmettre, c’est aussi de faire justement dans l’épaisseur d’un récit. Il y a toutes ces strates de langage et pour moi c’était aussi une façon de mêler à la fois sa vie, à la fois les textes, à la fois tous ces niveaux de langue que je pouvais découvrir dans ses textes ou les résonances qu’il y avait dans ses textes avec des choses qu’elle avait vécues et où tout à coup elle donnait une dimension tout à fait personnelle alors qu’elle parle de drames qui sont à d’autres. Elle adorait la Grèce, le théâtre antique, la poésie antique, et elle va découvrir le massacre de Kalavryta dans le Péloponèse.
(Le massacre de Kalávryta, également appelé l'holocauste de Kalávryta est un crime de guerre nazi perpétré par des membres de la Wehrmacht, le 13 décembre 1943, dans le village de Kalávryta au cours de l’occupation de la Grèce pendant la Seconde Guerre mondiale. (Wikipédia)
"Tout était si lourd et nous avions tellement besoin de luxe, d’inutile. "
Marie-José Del Volgo :
C’est un peu difficile d’intervenir après. Je voudrais raccrocher à cette question du soin tel que je l’entends. D’abord la poésie qui est une manière de soigner. Il faut quand même dire qu’ici on est dans un théâtre et que Richard commence toujours ses universités populaires par un poème. Donc la poésie est omniprésente ici. Vous avez parlé de rendre la tendresse. La lucidité dont Charlotte Delbo faisait preuve. Quand Roland Gori a évoqué ce cycle ‘Culture, soin et démocratie’, il a immédiatement proposé votre livre ‘ Charlotte Delbo’. Je ne l’avais pas lu. Quand j’ai commencé à lire votre livre, cela m’a paru une évidence pour beaucoup de raisons. C’était une manière très décalée de parler des soins et sortir de tout ce qu’on a pu dire sur la médicalisation de l’existence qui peut donner des choses assez monstrueuses, notamment à l’hôpital et dans la médecine que je connais bien puisque j’y ai travaillé en tant que médecin. Avec votre livre, c’était se décaler complètement et en même temps être au cœur de la question. Dans ‘spectres mes compagnons’ Charlotte Delbo dit : « Tout était si lourd et nous avions tellement besoin de luxe, d’inutile. »
Roland a pour habitude de parler de cette ‘inutilité’ si importante, l’amour etc. ces choses parfaitement inutiles mais tellement importantes. Cette question du soin que nous avons mise entre la culture et la démocratie c’est sans-doute faire l’éloge de cet inutile pour parler du soin et sortir de cette médicalisation. Jouvet, Richard Martin, c’est le théâtre qui est là en permanence et ce que j’en ai compris, c’est que Charlotte Delbo a commencé par les poésies dans son enfance, et le théâtre qui est arrivé comme cela par hasard, ensuite l’écriture. Puis elle revient au théâtre en écrivant, mettant en scène… Le théâtre est très présent et pour Roland cela s’est imposé et cela m’a beaucoup parlé. J’ai lu votre livre comme un écrivain qui parle d’un autre écrivain, d’une poétesse, Charlotte Delbo. J’ai beaucoup aimé quand vous avez parlé de Dom Juan. Charlotte Delbo n’était pas du tout d’accord avec le jeu de Dom Juan et ce que j’ai aimé par rapport à sa vie retrouvée, elle dit : ‘Pour Jouvet, Dom Juan savait son destin alors que pour Delbo Dom Juan a encore l’espoir de gagner'.
Il y a cette notion d’espoir qui est très importante et vous précisez qu’elle fait une lecture de Dom Juan nourrie de sa propre expérience. Elle dit dans une émission avec Jacques Chancel : "Il faut vivre. La vie, c’est la vie". Elle ne se pose pas de question. Je trouve cela formidable parce qu’on se pose tellement de questions : la vie vaut-elle la peine d’être vécue. Elle, malgré tout ce qu’elle a vécu dit ‘Non, c’est la vie’. Elle dit à Jouvet, et là encore on est dans une forme de soin, « Avec vous je retrouve mes phrases, mon mouvement de paroles, ma respiration. Comment avez-vous fait cela ? » . Il y a par contre l’histoire du fils de Jouvet qui ne parle pas des transcriptions qu’elle a faites.
il y a aux Etats-Unis dans les universités ce qu’on appelle les Holocost studies, des départements où on étudie les textes qui ont été écrits sur les camps nazis et parmi les grands écrivains de la littérature
Ghislaine Dunant :
Il y a deux volumes chez Gallimard des cours de Jouvet : ‘Molière, Racine et le théâtre du 19e’ qui sont entièrement les transcriptions faites par Charlotte Delbo, prises en notes puis retranscrites, c’est passionnant et j’ai tout lu. Le premier volume est sorti en 65, le deuxième en 68, Charlotte a écrit au fils de Jouvet en disant : « Mais enfin, on aurait au moins pu mettre que ces cours avaient été faits oralement, pris en notes par Charlotte Delbo, et retranscrits par elle. » Rien n’a été fait. Il y a également une pièce qui a été faite ‘Elvire Jouvet’ pour montrer ce qu’est un cours quand Jouvet fait répéter Elvire dans la salle du conservatoire en 1940, une pièce absolument extraordinaire, dont une captation a été faite par le cinéma. Benoit Jacquot l’a fait et c’est très bien. On ne dit nulle part que si nous avons ce texte c’est grâce à Charlotte Delbo. Je voulais, en écrivant ce livre, qu’on sache qu’il y a quelqu’un qui s’appelle Charlotte Delbo qui a été une femme absolument extraordinaire. Son œuvre est beaucoup plus connue aux Etats-Unis qu’elle ne l’est en France car il y a aux Etats-Unis dans les universités ce qu’on appelle les Holocost studies, des départements où on étudie les textes qui ont été écrits sur les camps nazis et parmi les grands écrivains de la littérature il est évident que l’œuvre de Charlotte Delbo, entièrement traduite aux Etats-Unis est étudiée. Mon livre est d’ailleurs en ce moment en cours de traduction et va paraitre aux Etats-Unis.
Marie-José Del Vago :
J’avais lu Elie Wiesel qui écrit dans ‘cœur ouvert’ : ‘Tel est le miracle, une histoire de désespoir devient une histoire contre le désespoir’.
Vous avez dit comment cela pouvait l’être : la puissance de l’écriture etc. mais c’est un peu énigmatique. Vous écrivez ‘L’homme qui souffre échappe à sa souffrance grâce à celle d’Œdipe’. Et je me suis dit on peut rajouter aujourd’hui Charlotte Delbo puisque sa vie fait, d’une certaine façon, rêver. Une question sur votre livre ‘L’effondrement’. Est-ce une manière de nommer la dépression ?
Ghislaine Dunant :
Oui pour moi dire dépression aurait été une stigmatisation. Je raconte quelque chose qui m’est arrivée il y a 35 ans. La narratrice devient comme un personnage et se met en scène mais pour moi c’était le moyen aussi, avec l’écriture, d’aller dans les moments où le rapport à la vie pouvait devenir tellement ténu mais que la vie était encore là. La narratrice reprend vie peu à peu avec un autre patient qui est dans le couloir qui s’appelle Robert. Peu à peu va se nouer une sorte d’amitié, de lien –c’est un garçon qui a de l’humour à sa façon- des choses extrêmement ténues avec les autres. C’est une façon de montrer que si, dans un effondrement, le contact avec la réalité peut sembler perdu d’une manière effroyable, comme un éloignement de ce qui est vital, de cette énergie vitale, il y a toujours quelque chose de très ténu et que l’écriture est capable d’être ce lien et ce fil qui peut ‘dire’. C’était important de faire un récit et que cela courre tout au long, que l’on voit que l’écriture, c’est aussi un souffle, un lien, comme l’eau qui coule, tresser quelque chose. Un lien, c’est un fil qui est tressé.
"Au milieu des hommes on tient. ....C’est impossible de se sortir d’ici. Elle voudrait se coucher dans la boue et attendre d’être trouvée morte par la kapo. Sans les mots, la mort et la boue sont là."
Roland Gori :
Dans un texte de Charlotte Delbo, après ‘Spectre mes compagnons’, elle dit : ‘"Les créatures du poète ne sont pas des créatures charnelles, c’est pourquoi je les nomme spectres. Elles sont plus vraies que les créatures de chair et de sang parce qu’elles sont inépuisables. Elles sont mes amies, nos compagnons, ceux grâce à qui nous sommes reliés aux autres humains dans la chaine des êtres et dans la chaine de l’histoire. "
Cela me paraissait important peut-être en réponse à ce que vous lui faites dire en la citant : "Au milieu des hommes on tient. Seule elle ne peut tenir ses pensées ne serait-ce que pour l’angoisse qui les habite toutes. C’est impossible de se sortir d’ici. Elle voudrait se coucher dans la boue et attendre d’être trouvée morte par la kapo. Sans les mots, la mort et la boue sont là."
Et vous écrivez : "Les mots la raccordent à elle, la font ‘un sujet’ et quitter le trou, le travail pour raccorder le trou, ce trou dans l’humain, fait par une violence inouïe, le trou des disparitions, des corps assassinés sans sépulture. Elle a cherché à écrire pour tisser la trame qui la raccommode. Ecrire l’œuvre qui me raccorde à ce qui fut."
Ma question est : comme vous j’adore Benjamin et le conteur, Le narrateur, son travail de 1936. Depuis des années, j’ai dit un peu la même chose : nous avons perdu la faculté qui me paraissait inaliénable, celle de raconter des histoires. Ce que dit Benjamin, au retour d’une boucherie, celle de la première guerre mondiale. L’évènement n’avait pas pu être raconté, même s’il nous avait traversé. C’est la thèse de Benjamin. Je me rends compte ce soir après vous avoir lue plusieurs fois, après avoir écouté l’interview de Charlotte Delbo chez Jacques Chancel, après avoir entendu plusieurs fois Ghislaine Dunantet notamment à ‘la grande table’ à France Culture, ce soir, je me dis mais : est-ce que vous n’ouvrez pas quelque chose d’une thèse que nous affirmons, c’est-à-dire que le récit est impossible –jusqu’au niveau de la psychanalyse d’ailleurs- s’il y a un traumatisme qui, encapsulé d’une certaine façon, ne peut plus se diluer dans la langue et dans la parole. Or ce que vous nous apportez est presque une contradiction par rapport à cette thèse. Pourtant cette thèse vous y adhérez car vous avez évoqué le travailleur de Benjamin avec ‘Le conteur’. Charlotte Delbo dit sans arrêt ‘ce ne sont pas des rêves’. On ne peut pas rêver à Auswitsch, on délirait. Vous en faites un récit, à partir des traces de récits qu’elle a laissés dans ses œuvres. Nous adhérons à cette thèse qu’il y a des évènements qui nous délabrent psychiquement, qui sont de vrais traumatismes. Etant encapsulés, on ne peut plus en rêver. Si on ne peut plus en rêver on ne peut plus les dire. On peut éventuellement en parler, pas les dire. Il faut écouter l’interview de Charlotte Delbo chez Jacques Chancel en 1974, elle a une voix d’enfant. On se dit comment est-ce possible qu’elle ait pu traverser toutes ces horreurs, qu’elle ait pu à la fois dévoiler le poétique dans le tragique et le tragique dans l’ordinaire et garder cette voix d’enfant. N’y-a-t-il pas là quelque chose qui vient enfoncer un coin dans la thèse que nous reprenons tous selon laquelle il y a des choses qu’on ne peut pas dire parce qu’on ne peut pas en rêver, et on ne peut pas l’écrire ?
Ghislaine Dunant :
Deux choses pour tenter d’y répondre. C’est de dire que la singularité de l’œuvre de Charlotte Delbo, c’est justement ce que je dis dans l’introduction que je fais : Elle a fracassé la forme du récit, brisé le continu de l’expérience, utilisé des formes littéraires différentes, un tableau, une scène, un dialogue, un poème, ou quelques lignes isolées sur une page. Pour écrire ce qui n’était pas imaginable, il lui fallait recommencer chaque fois avec un autre souffle, trouver une nouvelle densité au récit. Elle n’a pas cherché à nous convaincre de ce qu’elle avait vécu mais a voulu rendre à notre conscience ce qui avait eu lieu, nous donner à entendre par la force de ses mots et de son style la catastrophe qui a fait une fracture dans notre humanité et nous donner la possibilité de nous y raccorder par l’émotion, la sensation. C’est-à-dire justement il s’agit de faire des choses brèves, en changeant à chaque fois de forme, par moment un chapitre, par moment un dialogue, par moment un poème, à la fois pour recommencer avec un autre souffle d’écrivain pour donner une densité parce qu’elle affronte l’inimaginable. Je pense aussi qu’il y a une raison intéressante –qui est venue du dialogue avec une amie psychanalyste- qui me disait quand Charlotte voit cette femme avec ce haillon jaune qui s’arcboute pour monter du fossé, ‘Maman me dit que Flac, notre chien va mourir’ affleure, rentre dans le récit. En fait, c’est le premier trauma de Charlotte Delbo, la première fois qu’elle rencontre la mort. Elle a cinq, six ans. Le chien de la famille est en train de mourir. Ce traumatisme revient au moment où elle vit un autre traumatisme qui est l’horreur de ce qui est vécu. C’est, pour moi, une des explications. La chose essentielle pour moi était, en tant qu’écrivain, trouver ces formes brisées, densifiées à sa manière à elle, pour leur donner une vie d’œuvre littéraire qui nous est rendue par la sensation, l’émotion. Que ce soit le corps qui ressent et qu’elle nous traduise avec ses mots à elle, poétiques, ce que le corps vivait, le corps agressé, le corps mutilé, le corps à la limite de succomber ou qui succombe. Raconter le corps et l’émotion qui est au bord de ne pas supporter parce que sa pitié est tellement éprouvée. Voilà comment j’analyse cette façon de dépasser un traumatisme.
Marie-José Del Vago :
D’une manière plus triviale et dans ce qui nous intéresse de l’humanité, n’est-il pas possible qu’elle ait eu toute cette culture du théâtre, de la poésie ? Vous avez évoqué d’emblée les poèmes qu’on apprenait enfant et qui nous nourrissaient même si ce n’étaient que des récitations, est-ce que ce n’est pas cela ? Et en tant que résistante aussi, c’est un sacré engagement. Est-ce qu’on ne manque pas d’engagement ? Je pense à Liliane Halterqui, elle, est rescapée du ghetto de Varsovie et qui, au contraire, est restée 60 ans renfermée dans son traumatisme. Elle n’a pas pu parler, n’a pas pu s’ouvrir au récit.
C’est une Humanité augmentée, pas dans le sens où on l’entend aujourd’hui, augmentée par la culture
Ghislaine Dunant :
Cette scène où en prison, elle lit. C’est cette première expérience de la lecture qu’on a tous fait où on vit au diapason des personnages et ce n’est pas tant l’art du romancier qui nous touche mais ce qu’on garde en mémoire, c’est ce qu’on a vécu intérieurement. Elle le dit, c’est au fond son émotion de lectrice. C’est en tant que lectrice émue qui est partie avec son imaginaire qui a vécu et c’est cela qui parle. Ce n’est pas une littéraire qui se souviendra de l’art du romancier. C’est celle qui a eu une extension de l’émotion, une extension humaine de la vie du héros. Quand on lit, quand c’est fait par l’auteur, par le romancier et que c’est réussi, on vit ce que vit le personnage. Quand elle fait venir Fabrice Del Dongo ou même Alceste, ce sont des personnages agrandis. Ce n’est pas une lecture de quelqu’un qui a analysé etc., c’est une lecture vraiment humaine qui lui a donné une densité beaucoup plus grande. C’est cela qui la fait sortir du trauma. En somme c’est une Humanité augmentée, pas dans le sens où on l’entend aujourd’hui, augmentée par la culture.
L’histoire de l’humain nous gifle constamment
Richard Martin :
Je rebondis sur ta réflexion Marie-Jo et la relation qu’il peut y avoir avec le théâtre. Le propos est absolument mixé. Je dirai, Ghislaine, que dans cette espace de résistance poétique, cette intervention prend tout son sens, nous relie à cette humanité effectivement, comme Homère a pu nous l’offrir. L’histoire de l’humain nous gifle constamment. Au-delà de l’adresse de l’écriture, c’est cette humanité que je retiens et qui nous montre l’essentiel. Et aussi à-travers toutes ces anecdotes et aussi la vanité de quelques-uns qui peuvent se prétendre poètes et qui, dans le meilleur des cas, ne peuvent que les servir. L’anecdote sur Jouvet m’attriste un peu. Il fait partie de ceux qui ont construit le théâtre non réservé à des cercles de privilégiés, de tous ces gens du cartel et ceux qui nous ont mis sur la voie du théâtre, du vers et de la culture pour tous. Je regrette que cet artiste de grande valeur n’ait pas compris tout de suite à qui il avait affaire. Tant pis pour lui. Grâce à vous Ghislaine, je rencontre quelqu’un ce soir que je connaissais mal et dans l’écriture de laquelle je vais me plonger. Vous me donnez la direction de l’essentiel. Je crois qu’on est encore avec un compagnon poète majeur avec laquelle il va falloir bien compter au-delà de votre talent pour le faire. On est dans ce tremblement des limites où le mystère nous gifle. Cela, c’est un cadeau superbe que l’on partage ici, même si nous ne sommes qu’une chapelle. Cette chapelle se souviendra de ce cadeau que vous venez de nous faire. C’est vrai qu’on peut en entendre parler radiophoniquement, qu’on peut finir par se demander qui est cet auteur, mais là c’est quelque chose qui, en ce qui me concerne, vient de me frapper. Je ne peux pas imaginer que mes compagnons ne soient pas frappés de la même façon. Cette ambassade est extraordinaire et nous l’emportons à notre tour. Merci vraiment pour tout cela. Je suis très touché.
Vous parliez de cette main violette qui retombe. Ce que je cherche constamment c’est ramener cette humanité vers le beau. Cette simple écriture nous l’offre immédiatement. Il n’y a pas une seconde de fatigue intellectuelle dans votre récit. Nous sommes tous aux aguets, tout le temps. Pas une seconde où on peut décrocher sur le plaisir d’en savoir davantage sur ce personnage qui est une belle personne et que je pense, on ne doit pas seulement à votre talent car si vous avez réussi à faire cela c’est qu’il y a vraiment quelque chose de fort. J’ai pensé à un certain moment : ‘mais vous êtes une policière extraordinaire !’.
Oui, c’est une véritable enquête. Dans la simplicité de ce récit-là on trouve les indices qui nous font comprendre.
*Danielle Casanova, née Vincentella Perini le 9 janvier 1909 à Ajaccio et morte le 9 mai 1943 en déportation à Auschwitz, est une militante communiste et résistante française. Elle a été responsable des jeunesses communistes et a fondé l'Union des jeunes filles de France. (wikipedia)
Merci au Théâtre Toursky d’ouvrir grand, sous toutes ses formes, le monde de la culture.