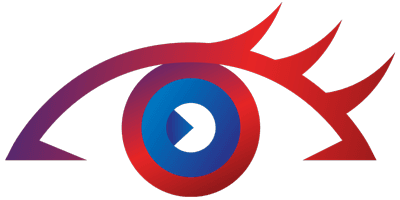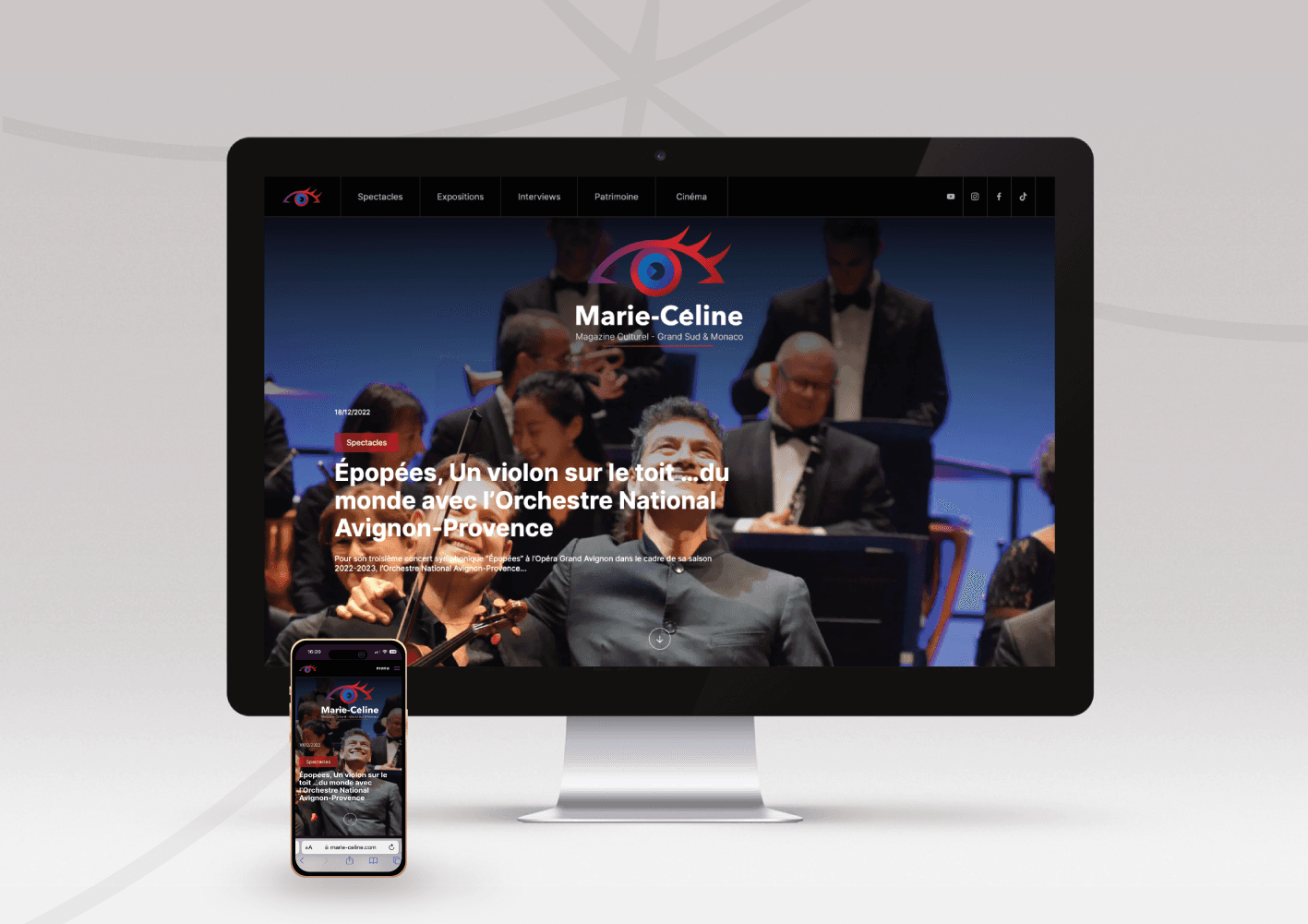- Auteur Danielle Dufour-Verna
- Temps de lecture 18 min
Gilles Ascaride un intellectuel en goguette

Écrivain, Comédien, Gilles Ascaride, metteur-en-scène à l’âme sensible et à la verve étourdissante
Marseille, c’est un peu le credo de Gilles Ascaride, un comédien sociologue au franc-parler qui décortique les émotions, les émois, les états d’âme et les traduit dans un langage fleuri et des mots rafraichis à faire pâlir d’envie tous les ‘mistral’ et bourrasques de notre bonne vieille cité phocéenne. Cet analyseur de sentiments crie avec génie son attachement à sa ville en pointant ses défauts, comme le ferait un vieil amoureux désappointé devant le peignoir fatigué de sa belle : « Tu t’laisses aller, tu t’laisses aller… »
Il a écrit des livres, tous publiés, joué et mis en scène des tas de pièces. Lui, c’est Gilles Ascaride, pas le frère d’Ariane, artiste aux nombreuses récompenses. Non ! Car bien que les liens fraternels les unissent indiscutablement, cet homme-là a largement et depuis longtemps gagné le privilège de ne plus être le frère de…comme on est le fils de… mais un artiste à part entière dans sa singularité et la résonance de son œuvre.
À cœur ouvert, à corps perdu, Gilles Ascaride se met à nu dans une conversation à bâtons rompus. Voici, pour coller avec humour au style de l’écrivain, une phrase qui résume la formidable interview que Gilles Ascaride nous accorde en ce mois de janvier 2020. Dans le jardin, les fleurs d’amandier, à peine écloses, tendent leurs fines corolles et s’abreuvent du rire de l’artiste, si communicatif. Au loin, la Vierge de la Garde, sur ses gardes, dresse fièrement son mât, guettant des mots qui ne sauraient la blesser. Gilles Ascaride, en grande forme, révèle avec pudeur une intimité à peine voilée, celle d’un esprit généreux, voire tendre qui cache sa délicatesse sous une réputation de ‘fort en gueule’ à la verve prolifique.
Projecteur TV Danielle Dufour Verna : Gilles Ascaride, parlez-nous de vous, de votre début de carrière.
Gilles Ascaride : J’ai 72 ans. En fait, j’ai commencé ma carrière à Marseille au Théâtre Toursky !
J’ai fait partie de la dernière troupe de l’ancien théâtre. J’avais dix-huit ans quand j’ai joué la première fois en professionnel au ‘Théâtre quotidien qui est devenu le Toursky. Ce texte « Sur tes ruines j’irai dansant », je le portais depuis 25 ans. Je me suis dit : « avant que je ne sois trop vieux, ce sera peut-être mon chant du cygne ».
Le Toursky c’est un bel endroit. A Marseille, je suis dans une éternelle mauvaise période. Pas un seul théâtre marseillais ne m’a ouvert ses portes, à part le Toursky, hier soir, pour la première fois. Je ne sais pas ce que je trimballe comme réputation. Il y a des gens qui me font une réputation de mec épouvantable, que j’ai un caractère de cochon, que j’emmerde tout le monde, ce qui n’est pas vrai du tout. C’est pour cela qu’en plus de Richard, j’ai tenu à remercier les trois copains avec lesquels j’ai travaillé. C’était délicieux. On s’est entendu comme larrons en foire au Toursky. Je ne suis pas consensuel, voilà.
Projecteur TV DDV : Vous avez nommé des copains dans la salle…
Gilles Ascaride : Mes copains d’enfance étaient là : ‘le gros, roro le jazzman et blond’. On est copain depuis la 5e du collège. C’est moi qui ai aidé à ce qu’on se retrouve tous. Quand j’ai écrit « J’ai tué Maurice Thorez » d’ailleurs, ils sont dans la pièce. Et c’est absolument extraordinaire : Un soir je les ai retrouvés, ils étaient venus voir la pièce, ils étaient dans la salle. On s’est tombé dans les bras même si on ne s’était pas vu depuis trente ans et depuis 2013 on ne s’est plus quitté. On s’est retrouvé avec la même amitié. On a une chance folle, c’est que nos femmes respectives, se sont super bien entendues et sont devenues copines. On aurait pu devenir des abrutis des gens qui ‘se la pètent’. Non, ce sont les mêmes. Comme je dis c’est la première fois que je suis vieux (rires) mais c’est irremplaçable de retrouver des copains comme ça et de pouvoir reprendre l’échange comme si le temps ne s’était pas écoulé. On rit souvent en disant maintenant : « Qui va mourir en premier’ parce que les autres ils vont ‘morfler’ de se retrouver seuls ». Si c’est moi qui meurt le premier bon, je ne le verrai pas, mais ça va être terrible, quoi. Alors on a dit on va prendre un avion et mourir ensemble tous les 4.
Projecteur tv DDV : Tous les 4 ? Non, tous les 8…
Gilles Ascaride : On ne va quand même pas faire mourir nos femmes (éclats de rire)
Projecteur tv DDV : Qu’est-ce-qui vous a amené à faire ce métier ? Parlez-moi de votre enfance.
Gilles Ascaride :
Mon père est né à Marseille dans ce quartier du Vieux Port qui a été détruit en 1943 et avait l’avait quitté en 38 lors de son mariage. Tout le reste de sa famille a été délogée et déportée à Fréjus. Dans la famille Ascaride, mon père était un fils d’immigrés, né de parents qui se sont fait naturaliser. Il voulait absolument qu’à la maison on parle uniquement le français, comme beaucoup d’immigrés de l’époque.
On a été élevé comme de bons petits français, sauf que dans ces cas-là, ça fuit toujours de quelque part, un peu à la cuisine, certaines phrases. Aucun de nous n’a de prénom italien, Ariane, Pierre, Gilles et déjà mon père s’appelait Michel alors que mon grand-père s’appelait Eugenio et Giuseppa ma grand-mère. La volonté d’intégration a été forcenée. Mon père n’avait pas fait d’études mais c’était un homme courageux, qui a été résistant, qui a été FTPF*. (Francs-tireurs et partisans français)
C’est quand il est mort qu’on a trouvé dans ses affaires des papiers de la Résistance qu’il ne nous avait jamais montrés. Il a adhéré au parti communiste en 1943 et a fait les maquis en Lozère. Dans la résistance communiste, il a rencontré des artistes, des intellectuels, des gens comme Gaston Mouren, compagnon de route de Marcel Pagnol, pétri de culture. Il était fasciné par cela. Il a été un autodidacte furieux qui s’est mis à apprendre seul tout ce qui lui tombait sous la main : lecture, opéra, théâtre etc. A la libération Gaston Mouren a créé une troupe de théâtre qui s’appelait ‘Les quatre vents’, très connu à l’époque à Marseille car il faisait un vrai travail de pionnier. Ce monsieur Mouren que j’ai bien connu, qui m’a formé en partie, disait : « Nous les amateurs on n’est pas là pour jouer les classiques etc., on doit faire découvrir des auteurs, faire découvrir des textes ».
Par exemple ce sont les premiers qui ont joué Brecht à Marseille. J’ai donc été élevé là-dedans, avec un père qui voulait qu’on aille à l’école, qu’on travaille bien, qu’on soit cultivé. Mon père nous menait au cinéma, au théâtre, à l’opéra. Il nous menait écouter des concerts classiques. Comme lui-même faisait du théâtre dans cette troupe, on allait, tout petits, régulièrement voir jouer papa. Il avait commencé à travailler à l’âge de 12 ans et il a découvert tard qu’il existait un conservatoire à Marseille. Il nous a dit : « Vous allez aller au conservatoire, apprendre, perdre votre accent marseillais, faire de l’art dramatique » mais lui ne voulait pas que l’on soit des artistes. Pour lui on a fait des études, on est allé à l’université. Mon frère, lui, faisait une licence de physique-chimie et il s’est rendu compte que ce n’était pas son truc et il est parti dans le théâtre et mon père n’était pas content.
Pour ma sœur, cela a été la même chose.
Il n’y a que moi.
Pour moi, ce métier, il faut le couper au milieu. La plus grosse partie de ma vie n’est pas consacré au théâtre. Je suis l’entre-deux : entre deux femmes, entre deux villes Marseille et Aix. Je ne suis pas d’une ville, je suis de deux villes et j’ai été de deux métiers. J’ai fait des études de sociologie. Ma famille n’était pas riche et pour continuer à faire des études, je gagnais ma vie en faisant du théâtre. J’ai lâché en 70 l’université au lieu de faire ma maitrise et je suis parti faire du théâtre avec mon frère.
J’ai découvert là qu’en fin de compte ce qui me plaisait par-dessus tout c’était créer, pas être comédien. . J’ai compris que je n’avais pas envie que les gens me regardent. Je n’étais pas content qu’on me regarde. En 1970/72 on m’a demandé d’écrire une pièce sur les bandes dessinées car à l’époque j’étais un fanatique des bandes dessinées. Je m’y suis mis avec acharnement faisant entrer les pieds nickelés, Beccassine etc. Elle a été jouée à Angoulême pour le festival de la bande dessinée mais je ne l’ai jamais jouée personnellement. Je suis donc parti et j’ai eu la chance de rentrer à l’université, de gagner ma vie, de ne pas vivre dans cette espèce d’insécurité qui était le quotidien et qui me pesait terriblement. Pendant dix ans, cela a été la traversée du désert. Puis est arrivé 1981 et les radios locales autorisées. Il y a une radio crée par l’Union Départementale des Mutuelles des Travailleurs qui s’est montée à Marseille. Elle s’appelait Forum 92. Et là pendant deux ans, je me suis régalé. Je menais une vie de fou. Je faisais une émission le matin et j’arrivais à cinq heures du matin. A onze heures j’allais travailler à l’université. Je retournais faire des émissions après 17 heures et le dimanche. Pendant deux ans, je n’ai pas eu un seul dimanche après-midi.
Je me suis mis à faire du théâtre radiophonique, des sketchs en plus d’émissions sérieuses de culture, scientifiques etc. Deux ans plus tard, la radio s’est arrêtée et si, avant la radio, je supportais de n’avoir que l’université, après ce passage à la radio, ce n’était plus possible. Je me suis dit c’est le moment ou jamais de faire ce que tu as dans la tête depuis toujours, à savoir, l’écriture, ça se fait tout seul, tu n’as pas besoin d’équipe etc. A ce moment-là le théâtre était complètement évacué de ma tête. J’ai écrit un premier roman qui a été refusé, mais j’ai vu que j’y arrivais. J’en ai fait un second qui est presque passé mais… Alors j’en ai fait un troisième « Les Cheyennes », et celui-là a été publié.
J’ai organisé ma vie entre l’université où je faisais surtout de la recherche et qui m’assurait le pain et le couvert. J’ai d’ailleurs écrit des bouquins sur la sociologie mais sans grand intérêt pour moi. Je gagnais ma vie avec cela et à côté j’ai organisé mon temps de travail, mes vacances, mes week-end où je m’enfermais à écrire. Là mon épouse m’a beaucoup aidée. Et je suis devenu un écrivain. J’ai écrit quinze romans, tous publiés. Puis un jour je me suis remis à écrire une pièce de théâtre. J’en ai écrit une puis deux, mais personne ne me jouait. Puis on copain me dit j’ai un ami qui cherche des pièces. Je leur fait passer mes textes. Rien.
Donc j’y vais, et ce n’était pas mal du tout. Eux se sont ‘amourachés’ d’Ascaride et ont monté plusieurs de mes pièces.
« Pour les cinquante ans de ma sœur Ariane, je lui ai écrit une pièce qui s’appelle : Rencontre avec mon beau-frère ». Cette troupe monte la pièce et la joue en Avignon en 2006 avec un comédien qui ne convenait pas vraiment au rôle et le metteur en scène de me demander de l’interpréter. J’ai accepté en me faisant violence…
Projecteur TV DDV : Et vous vous êtes pris au jeu…
Gilles Ascaride : Je comprends ! Je me suis dit « mais je me régale ! » Nous avons fait six dates mais nous aurions pu en faire soixante tellement je prenais plaisir à jouer. C’était la première fois que je jouais ce que j’avais écrit. Il y avait là une grande différence. J’ai compris que je n’aime jouer que ce que j’écris. Nous avons joué ‘Rencontre avec mon beau-frère’ cent fois dans la France entière. Cela ne m’a pas rendu célèbre. Approchant de la retraite, je suis redevenu comédien et ne joue que mes textes. A part une pièce de Serge Valetti, écrite pour ma sœur, mon frère et moi dont nous avons fait des lectures six ou sept fois. J’ai donc remis le pied à l’étrier tout en continuant à écrire.
Avec ‘J’ai tué Maurice Thorez’ que j’ai joué 64 fois, j’ai bénéficié de l’aide de Philippe Caubère qui a été formidable. Il est venu et il a été emballé. Il est d’une grande générosité.
Après avoir rencontré Julien Asselin qui faisait la mise en scène d’une de mes pièces que je ne jouais pas, j’ai produit une pièce qui s’appelle Zoé, la tante Zoé, celle dont on parle tout le temps et qu’on ne voit jamais dans la fameuse trilogie marseillaise de Pagnol. Je l’ai faite en lecture spectacle avec l’aide de Julien
Projecteur tv DDV : La sociologie vous a-t-elle aidé à écrire le texte ‘sur tes ruines j’irai dansant’ ?
Gilles Ascaride : Non et oui. A priori je dis non mais si je veux être totalement honnête je dois dire qu’en sociologie j’ai beaucoup travaillé sur Marseille. J’ai d’ailleurs publié sur Marseille un bouquin qui s’appelle ‘La ville précaire’. C’est vrai qu’en faisant de la sociologie j’ai rencontré beaucoup de gens différents à Marseille, mais il y a assez peu de rapport. Peut-être une imprégnation.
‘Sur tes ruines j’irai dansant’ est parti d’un rapport particulier que j’ai avec Marseille. Et j’ai découvert que nous sommes des milliers à l’avoir. D’anecdotes, de choses que j’ai vues et qu’on m’a racontées. Je me suis servi de tous ces ingrédients pour faire ce bouillon de culture.
Projecteur TV DDV : Dans ce bouillon de culture, comme vous le dites si bien, il y a le jargon marseillais mais surtout des références littéraires extraordinaires, comme ce sous-préfet aux champs de Daudet… Entre les interjections balancées avec verve, le langage est très châtié en fin de compte
« Je fais confiance en l’intelligence des gens » « Marseille est une ville multiple, contradictoire »
Gilles Ascaride : Il y a des clins d’œil à Molière, à la Bible, à Daudet, à Labiche. Ce matin un copain me disait : « Les gens ne reconnaissent pas toutes ces références ». A priori je fais confiance en l’intelligence des gens. Je ne sais pas faire autrement. Je ne fais pas une littérature de l’élite mais je me dis que même si des références sont loupées, ça passe. Si les gens chopent les références au passage, ça me plait. Je ne vais pas passer une heure et demi à dire ‘va te faire enculer, salope’. Cela n’a pas d’intérêt. Marseille est une ville multiple, contradictoire, ça lui ressemble. Comme je dis toujours « C’est une ville qui a du génie mais qui manque d’intelligence ». Marseille, c’est une espèce de camaïeu et c’est comme cela qu’il faut sortir le texte.
Par exemple, le texte d’André Suarès, Marsiho, est magnifiquement écrit. Il ne dit pas de gros mots mais en même temps c’est d’une violence incroyable. Je suis l’enfant de tout cela, je suis le produit de tout cela. Je suis le produit de Pagnol. J’ai relu dernièrement ‘La fille du puisatier’, je me suis dit, ce mec il est colossal. Ils ont repassé à la télé Manon des Sources et Jean de Florette. Je dois dire qu’Auteuil me fait baver, je l’adore. Je me suis dit ‘je m’y remets’. Je me suis régalé comme la première fois. Il y a cinquante millions de lectures dans Pagnol. Je viens de là.
Projecteur tv DDV : Votre texte n’est pas violent ! On ressent du désespoir, de l’amertume, de la souffrance, pas de la violence.
Gilles Ascaride : Je ne dis jamais que Marseille est une ville violente. Je dis que c’est une ville de la tension, ce n’est pas pareil. Je dis en même temps, c’est l’endroit où j’ai le plus ri au monde. Il y a une inventivité de l’homme de la rue. Il y a des trucs qui sont tels quels dans mes pièces. Je meurs de rire, je me dis quelle inventivité ! Et parfois noir et sombre. Car les gens sont souvent sombres à Marseille mais il y a toujours cette espèce d’humour, cette façon de se moquer de l’autre. C’est une vraie culture.
Projecteur tv DDV : Un peu comme à Naples…
Gilles Ascaride : Mon père me disait toujours cela, et quand je suis allé à Naples, j’ai trouvé les Napolitains très gentils. C’est une ville pourtant bien plus dure qu’à Marseille.
Projecteur tv DDV : Ce texte ferait un malheur à Naples…
Gilles Ascaride : Une amie journaliste napolitaine qui habite Marseille, Stefania Nardini, qui vient d’écrire un livre sur Jean-Claude Izzo, m’a dit un jour « Tu es un Français qui écrit comme un Napolitain »… En plus, ma famille vient de là.
Projecteur tv DDV : Parlez-nous de vos projets
Gilles Ascaride : Je joue en septembre au Centre Aragon de Septèmes les Vallons qui coproduit le spectacle. Orange affiche complet et nous attend la semaine prochaine. J’ai créé depuis 2011 à Septèmes un Festival Over Littérature qui se tient tous les deux ans avec un immense succès cette année. Je réfléchis sur une nouvelle création pour 2021. Pour le reste, les théâtres maintenant demandent des captations. C’est un contresens. Pour un théâtre qui se trouverait à Strasbourg, je peux comprendre, mais pour notre région… j’ai joué plusieurs fois en Avignon avec Philippe Caubère (j’ai tué Maurice Thorez) mais l’investissement personnel et financier pour faire Avignon est démentiel. Dans le cadre d’une co-production comme nous l’avions fait pour ‘Mlle Espérance’, l’histoire d’une vieille chanteuse, oui mais sinon c’est trop difficile financièrement. Je ne suis pas quelqu’un qui a beaucoup d’entre-gens. Je ne fréquente pas beaucoup de monde du théâtre.
Projecteur tv DDV : Le bonheur c’est quoi pour vous ?
Gilles Ascaride : Le bonheur c’est d’être vieux. C’est vrai ; ça me va très bien. Et depuis que j’ai pris de l’âge c’est d’être débarrassé de l’angoisse-dépression. C’est le bonheur total pour moi. Après il y a les petits bonheurs de tous les jours, comme le spectacle d’hier soir. Depuis minot, ma vie est une vie de souffrance : torturé, angoissé, terrifié ; une souffrance contre laquelle j’ai toujours lutté. Je me suis défendu contre tout, contre l’école, contre l’armée, contre moi-même. Et passé la cinquantaine, ça a commencé à aller bien. Maintenant que je suis vieux, que je ne fais que ce que je veux.
La retraite est un bonheur pour moi, je n’ai aucune obligation. Si je ne joue pas, je mange quand même. Cela c’est mon luxe. Je suis l’homme le plus heureux de la terre même si je ne joue pas au Gymnase ou à Chaillot, je m’en moque.
Quant à l’écriture, pour moi, cela n’a jamais été une thérapie, c’est la construction d’une œuvre d’art. ‘Sur tes ruines j’irai dansant’, est le premier texte que j’ai écrit en 1994 dans un bonheur inouï. Je me tordais parfois de rire en l’écrivant au point d’en avoir les larmes aux yeux. Je me faisais de la peine. En fin de compte, le bonheur, c’est me mettre dans mon canapé et ne rien faire. De regarder passer le temps. De dire ‘Il fait beau, il ne fait pas beau, il pleut’. Je me relaxe, je réfléchis. Le bonheur c’est aussi de rien faire et de profiter de la vie. Jusqu’à 55 ans, la joie de vivre, je n’ai jamais su ce que c’était.
Projecteur tv DDV : Gilles Ascaride, voulez-vous ajouter quelque chose avant que nous concluions ?
Gilles Ascaride : Comme le disait Letizia Bonaparte : « Pourvou que ça doure ! »
Si ce n’est pas de la philosophie cela….